doctorat
Trois écoles doctorales
Le laboratoire MAP peut accueillir des doctorants au sein de chacune de ses trois équipes. Elles inscrivent leurs doctorants dans l’une des trois école doctorales du MAP : ED IAEM (ED 77) à Nancy (Crai), ED Sciences Sociale (ED 483) à Lyon (Aria) ou ED Abbé-Grégoire (ED 546) à Paris (Maacc). Vous pouvez également retrouver la liste des thèses soutenues au MAP dans l’archive en ligne HAL en suivant ce lien.
ED IAEM (ED 77)
L’École Doctorale IAEM-Lorraine est l’une des huit écoles doctorales de l’Université de Lorraine : elle compte 319 doctorants au 1er janvier 2023. 94 thèses ont été soutenues en son sein en 2022.
Elle s’appuie sur onze laboratoires de recherche et équipes de laboratoires, dont le MAP-Crai de l’ENSAN. La population scientifique compte environ 550 chercheurs, dont 300 sont habilités à diriger des thèses.
ED Abbé-Grégoire (ED 546)
L’École Doctorale Sciences Sociales est l’une des deux écoles doctorales du Conservatoire national des arts et métiers : elle compte 251 doctorants.
Elle s’appuie sur quatorze laboratoires, dont le MAP-MAACC de l’ENSAPLV. Son périmètre thématique regroupe les sciences humaines et sociales et les sciences de gestion.
Les thèses en cours
- Jeanne Petitpas. Proposition d’une méthode d’analyse semi-automatique dédiée à la documentation et l’observation scientifique de l’état de conservation du patrimoine architectural : cas des fortifications bastionnées. Université de Lorraine. Depuis 2025.
- Victoria Lerognon. Développement d’un cadre politique opérationnel pour supporter la transition numérique du secteur de la construction publique : une étude comparative France-Québec. Université de Lorraine et ETS Montréal. Depuis 2024.
- Fériel Moalla. Formalisation d’exigence de sécurité dans les modèles d’information du bâtiment pour la prévention des risques en phase de conception des locaux de travail. Université de Lorraine. Depuis 2024.
- Anwar Nelhawi. Développement de composants structuraux non-standards pour l’architecture en bois réalisés par fabrication additive. Application du procédé de Stratoconception®. Université de Lorraine. Depuis 2024.
- Maxence Lebosse. Étude du processus de réemploi du bois d’œuvre en vue de l’intégration de pratiques BIM. Université de Lorraine. Depuis 2022. ⟨NNT : s310075⟩.
- Mohammed El Amine Sehaba. Intelligence artificielle pour une architecture favorable à la santé.
Lyon 2. Depuis 2022. ⟨NNT : s379657⟩. - Anne-Cécile Cochet. Le design pour le réemploi des matériaux de construction. Paris HESAM. Depuis 2021. ⟨NNT : s273041⟩.
- Stanislas Kurakin. Architecture de l’oubli dans la ville hypermnésique : Inscriptions et suppressions mnésiques sur le support architectural à l’ère des méga-données. Université Paris 8. Depuis 2020.
- Kaouther Hachemi. Contribuer à la professionnalisation des étudiants en architecture : l’environnement numérique comme outil d’autoformation tout au long de la vie. Université de Lyon. Depuis 2019.
- Yulia Donetskaya. Optimisation du processus de la reconstruction 3D en temps réel pour la cognition de l’espace in-situ appliquée à l’architecture et au génie civil. Depuis 2018.
Les thèses achevées
Post-master


Post-Master de Recherche ENSAPLV
Les mutations et transformations territoriales, urbaines et architecturales observables dans bien des parties du monde actuel constituent un défi qui ne saurait se limiter aux seuls aspects spatiaux.
Observer ces transformations ne saurait donc suffire : il faut les comprendre pour mieux agir.
C’est dans cette orientation que la mobilisation des chercheurs est non seulement utile, mais nécessaire. Les recherches et la formation engagées autour des questions relevant de ces phénomènes de transformation et de mutation constituent de véritables entreprises de réflexion et de construction des connaissances et de savoirs fondés sur les exigences scientifiques.
Dans la mesure où les mutations observables concernent à la fois les formations spatiales et sociales, les démarches envisagées pour la compréhension des mécanismes à l’œuvre mettent au jour les changements des pratiques et l’élaboration d’autres catégories de pensée et d’action nécessaires à l’objectivation de nouvelles dynamiques. L’objet de ce Post-Master international est d’introduire de jeunes chercheurs à la compréhension de ces mécanismes et à la production de connaissances scientifiques essentielles aux domaines de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage.
Ce Post-Master Recherches en Architecture permet d’acquérir un bagage scientifique transversal qui explicite ces phénomènes et offre l’opportunité d’une première expérience de recherche au sein d’un laboratoire.
Objectifs et enjeux
Le but de cette année de formation est de s’acculturer au milieu de la recherche en architecture et de faire une première expérience de longue durée en laboratoire, autour de la rédaction d’un projet personnel de recherche.
Cette acculturation et cette expérience permettront d’acquérir de nouvelles méthodes et outils pour poursuivre un travail de doctorat en architecture ou développer de nouvelles compétences professionnelles.
Ce Post-Master est un lieu de présentation des approches scientifiques qui caractérisent divers laboratoires et qui, ensemble, participent à la richesse des énoncés et des questionnements dans les différents domaines. L’architecture, la ville et le paysage prennent, au sein de ce post-master, à la fois les rôles d’objets de recherche, de terrains de recherche et de contextes à partir desquels sont posées des questions théoriques et épistémologiques de production de la recherche.
Il prépare à de nouvelles pratiques professionnelles et/ou à l’inscription en thèse par l’approfondissement de connaissances internationales dans les domaines de l’architecture, de la ville et du paysage et, par l’acquisition de nouveaux savoirs-faire, méthodes et approches, différentes de celles découvertes dans le cursus initial en Architecture, en transmettant les enjeux scientifiques et passions des métiers de la recherche.
Ce post-master est construit dans un esprit d’ouverture et de transversalité afin de donner aux étudiants désirant s’engager dans un doctorat, la possibilité de découvrir, approfondir ou s’ouvrir à la recherche sur l’architecture, la ville et le paysage dans sa diversité. Il aborde les multiples facettes de ces domaines – la conception, la fabrication, les doctrines, la théorie, etc… de l’architecture, la ville et le paysage . Il s’agit de rapprocher de manière concrète et fertile les disciplines qui font le paysage de la recherche en créant des rencontres, des regards croisés et des transversalités fructueuses.
L’approche internationale de ce Post-Master permet aux étudiants de situer leurs sujets au sein de logiques qui se développent également hors de leurs frontières et de saisir les manières dont certaines thématiques se construisent ailleurs qu’en France. Cette approche internationale prend la forme d’un séminaire international (de 11 séances) ainsi que d’une journée d’étude dans lesquels des chercheurs étrangers seront invités à présenter leurs travaux et réflexions.
Ce séminaire international et cette journée d’étude permettent de créer des contacts directs entre les chercheurs étrangers et les étudiants.
masters spécialisés
Master Génie Civil Architecture Bois Construction
L’école d’architecture, en partenariat avec le collegium Lorraine INP de l’Université de Lorraine, propose plusieurs spécialités de master. Dans le cadre du master « Génie Civil », l’ENSA de Nancy et l’ENSTIB proposent la spécialité : Architecture Bois Construction.
Ce cursus permet aux architectes et ingénieurs d’acquérir une double compétence à travers une formation originale axée sur les techniques de mise en œuvre du bois dans le bâtiment.
Cette spécialité de Master vise à constituer une culture de la construction bois qui soit ouverte à une multiplicité de points de vue et partagée entre tous les acteurs. Elle conduit les architectes à se doter des connaissances techniques indispensables pour mener à bien un projet de construction bois et les ingénieurs à appréhender les multiples caractéristiques du matériau lors d’un projet.
Elle apporte enfin aux deux publics une connaissance réciproque pour apprendre à travailler ensemble afin d’optimiser le travail de conception et d’économie du projet en vue d’une meilleure qualité architecturale, technique et environnementale.
Les débouchés sont principalement :
- bureaux d’études
- bureaux d’ingénieries pluridisciplinaires du BTP
- bureaux de contrôle
- maîtres d’œuvre, entreprises de construction
- emplois en agence d’architecture (débouché principal pour les étudiants architectes)
La spécialité offre également une possibilité de poursuite d’études (doctorat en laboratoire d’architecture, de génie civil ou matériaux, …)
L’enseignement est assuré par une équipe pédagogique composée d’enseignants chercheurs et de praticiens (architectes, ingénieurs, industriels, …) spécialistes du domaine. Le Master est cohabilité entre l’École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois et l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy, en étroite collaboration avec l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg.
La formation, dispensée sur une année, est divisée en deux semestres :
- premier semestre : ENSTIB – l’École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois – à Épinal, les jeudis, vendredis et les samedis matins. Les étudiants et les auditeurs disposent des débuts de semaine pour des activités complémentaires (travail en agence, en bureau d’études, …). Les professionnels en activité (architectes ou ingénieurs) ont la possibilité de suivre la formation tout en conservant une activité partielle.
- second semestre : Les étudiants sont en stage en agence d’architecture, entreprise ou laboratoire.
Construire avec du bois : Cette spécialité de Master accompagne le développement du bois dans la construction et les actions mises en place à l’échelon national pour promouvoir ce secteur. Cette formation permet aux architectes et ingénieurs d’acquérir une double compétence à travers une formation originale axée sur les techniques de mise en œuvre du bois dans le bâtiment.
Elle conduit les architectes à se doter des connaissances techniques indispensables pour mener à bien un projet de construction bois et les ingénieurs à appréhender les multiples caractéristiques du matériau lors d’un projet. Elle permet également d’intensifier les collaborations entre ingénieurs et architectes afin d’optimiser le travail de conception et d’économie de projet, en vue d’une meilleure qualité.
La spécialité est accessible aux étudiants ayant validé, au moins une première année de master et, en double cursus, aux étudiants de 5e année d’architecture.
Master Design Design Numérique Architecture
Le parcours Design Numérique Architecture DNA fait partie des deux spécialité du Master Design co-organisé par l’Université de Lorraine, l’École Nationale Supérieure d’Art et de Design de Nancy et l’école d’architecture.
Le master est accessible en M2 aux titulaires d’un diplôme à bac+4, et en M1, aux titulaires d’une licence ou d’un diplôme équivalent, dans une spécialité en rapport avec le Design.
Ces parcours de M2 VDA est également ouverts à l’apprentissage.
Le parcours “Design Numérique et Architecture” s’intéresse au design d’objets architecturaux tant sur le plan de leur conception que celui de leur usage. Il vise à approfondir les connaissances des méthodes et outils informatiques d’assistance à la conception, à la simulation et à la représentation des données architecturales et urbaines.
Bien que relevant d’activités séculaires, la conception comme la production des espaces bâtis est aujourd’hui confrontée à de nouveaux défis.
Les architectes, les urbanistes, les ingénieurs et tous ceux qui concourent avec leurs compétences respectives à cette production doivent faire face à des exigences de plus en plus nombreuses et la prise en compte de la dimension environnementale apparaît aujourd’hui comme l’un des enjeux majeurs qui vient bousculer l’acte de construire.
L’évolution des facteurs relatifs au bâtiment (matériaux, confort, santé, énergie…) et celle des méthodes de conception (travail coopératif, projet à distance, intégration conception construction …) sont des expressions de cette transformation. Ainsi, les acteurs sont confrontés à une complexification des systèmes d’informations et de décisions, ainsi qu’à la nécessité d’anticiper avec justesse et raison la conception-production des espaces bâtis.
Le digital (Technologies de l’Information et de la Communication) a introduit dans ce contexte des changements importants. Des approches les plus généralistes, comme la Conception Assistée par Ordinateur, aux domaines plus spécialisés comme la simulation de la lumière, celles du comportement thermique et de l’empreinte environnementale d’un édifice, les modèles informatiques support à ces approches ont conduit à une rupture dans les comportements, dans les méthodes et les outils de conception, de communication et de contrôle des objets et des processus.
Dans ce contexte de modification de l’activité architecturale et de l’ingénierie qui lui est associée, ce parcours de Master vise à enrichir les connaissances dans le domaine des outils informatiques associés à des pratiques de conception architecturale durables et à les expérimenter dans de nouvelles approches du projet.
Objectifs pédagogiques
- Former à des attitudes rationnelles mais critiques en particulier en matière de conception, de simulation et de représentation
- Compléter et renforcer les compétences scientifiques et techniques en matière de conception
- Explorer de nouvelles pratiques du projet.
Objectifs professionnels
- Acquérir des compétences nouvelles (gestion de projet, techniques de modélisation avancées, maîtrise des outils de simulation…)
- Ouvrir de nouveaux champs d’intervention (conception lumière, ingénierie environnementale, pilotage de projet…) pour les métiers de l’architecture
- Préparer aux métiers de l’enseignement et de la recherche en architecture.
Formation second cycle
Le MAP dans le DEEA des ENSA
Les membres du MAP participent activement à de nombreuses formations en deuxième cycle (Master) au sein des ENSA de Lyon, Nancy et Paris-la Villlette, aussi bien à travers des enseignements d’initiation à la recherche qu’au sein d’ateliers de projet de conception architecturale. Ils sont impliqués dans plusieurs domaines d’étude (DEM) aux thèmes variés : innovation, pratiques alternatives, patrimoine, etc. Nos trois équipes accueillent en stage une quinzaine d’étudiants chaque année.
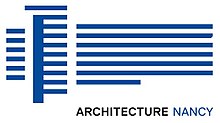
Les enseignants du champs STA (OMI et CIMA) de Nancy tentent de réaliser une transmission des recherches opérées en laboratoire dans la pédagogie. Cette démarche est notamment opérée pour les enseignements du Master Design Global Design Numérique et Architecture où les maîtres de conférences STA sont majoritairement représentés. De plus, dans une volonté d’impliquer les étudiants dans la recherche, nous proposons des axes de réflexions scientifiques dans le cadre des mémoires de master notamment dans le domaine Architecture, Ingénierie, Environnement (AIE).
Domaine d’étude Architecture, Ingénierie, Environnement
Quel rapport l’architecture entretient-elle aujourd’hui avec la technique ? Comment les pratiques actuelles (constructives, numériques, environnementales) prennent-elles place dans la conception architecturale et urbaine durable ?
En 2e cycle, le domaine Architecture, Ingénierie et Environnement (AIE), développe une méthodologie de projet et une culture constructive, au travers d’enseignements spécifiques adaptés aux enjeux contemporains liés à l’environnement. Il intègre des analyses et des expérimentations centrées sur des modèles éprouvés ou innovants, en prenant appui sur des connaissances historiques et contemporaines. Ces procédures se déclinent au sein du projet et du mémoire (professionnel & recherche)à diverses échelles (le milieu, l’édification, le prototypage) et intègrent plusieurs niveaux de complexité.
L’équipe de ce domaine d’étude vise à créer une synergie entre les différents acteurs de l’architecture, de l’ingénierie, de l’environnement (institutionnels, industriels, académiques et scientifiques) ainsi que les acteurs de la construction au travers de collaborations et d’échanges sur la base d’expérimentations et d’actions de recherches. Plusieurs offres pédagogiques se retrouvent en Master 1 et 2 associées à trois Masters co-habilités.

Les enseignants-chercheurs participent à l’enseignement en informatique de tronc commun des cycles Licence et Master de la formation des Architectes Diplômés d’État, ainsi qu’à l’encadrement des mémoires et de la mention recherche de master. Le laboratoire est partenaire du domaine d’étude de Master ALTer-natives, et pilote de deux ateliers de projets au sein de ce DEM. Ils sont également impliqués dans le DEM Héritages, Théories et Création où ils apportent leurs expertise en matière de relevé.
Domaine d’étude Architectures Latérales Théorisées
Le domaine d’étude ALT cultive l’ambition de former des diplômés en architecture ouverts aux mutations contemporaines et de développer leur force de proposition, dans une analyse critique des paradigmes émergents qui les entourent. Des pratiques alternatives et innovantes tentent de répondre à ces mutations et les étudier demande à considérer d’une part que se construisent de nouveaux usages, d’autre part que les concepteurs doivent envisager d’autres façons de produire le cadre des activités humaines. Ces diverses pratiques en construction, confrontées à des demandes non expertes, à des programmes mouvants, à des exigences souvent contradictoires, à des environnements contraignants, à des urgences exacerbées, doivent développer postures, outils et “bonnes pratiques” dans des visions prospectives et critiques souvent floues.
Les enseignements du domaine s’appuient sur une définition ouverte et non déterministe du projet d’architecture. Les étudiants sont enfants des crises, du développement durable et du numérique, ils vivent avec les médias en ligne et les réseaux sociaux, ils agissent local et pensent global… On s’appuiera sur les compétences acquises et la culture propre des étudiants, citoyens compétents : leurs capacités, leurs connaissances, leurs habitudes, leurs visions du monde sont les prémices de leurs postures et les moteurs de leurs stratégies, lesquelles se doivent également d’être cultivées et distanciées, des théories (doctrines) comme des outils (numériques) : une génération digital-native mais également digital-naïve.
Au-delà de la multiplicité des terminologies, des cultures et des références, le DEM ALT aura pour vocation à développer chez l’étudiant une posture critique à l’égard de ce qui se fait communément, une capacité à la prospective et à l’innovation, une ouverture à l’autre, une agilité d’esprit le rendant capable de s’adapter rapidement à tout changement de contexte. Partant, le DEM ALT ne peut faire lui-même que de changer continuellement, pour s’adapter aux idées naissantes, aux opportunités, à ses propres mutations : il doit être fondamentalement en perpétuelle reconstruction.
S’il s’appuie sur deux axes de recherche portés à l’ENSAL, (Dispositifs relationnels et participatifs du LAURE et Architecture et environnement numérique de MAP-Aria), le domaine d’étude ALT propose essentiellement d’expérimenter d’autres manières de concevoir, de produire et de penser l’architecture … et surtout de l’envisager comme une expertise, une capacité et comme un objet d’étude en propre.
ALT propose 6 entrées thématiques, questionnées à la fois tout au long des 4 semestres du séminaire et dans les autres dispositifs pédagogiques (ateliers de projet, workshops) :
- Les processus de création
- La mise en récit du projet
- La fabrique du commun
- Posture(s) critique(s)
- Fabrication / architecture maker
- Digital thinking
Domaine d’étude Héritages, Théories et Création
La construction d’un avenir durable impose de concevoir des pratiques projectuelles qui respectent l’existant et qui préservent et économisent les ressources matérielles, les sols et les sources d’énergies. Au regard de ces enjeux environnementaux et humains, une part majeure de la pratique professionnelle actuelle et future est centrée sur l’intervention sur l’existant. Il s’agit donc, avant même de créer et de produire, de penser les héritages comme première ressource du projet, en considérant les problématiques de mémoire, de réemploi, de recyclage, de mutation, de transformation, de réparation, de reproduction, d’analogie, d’évolutivité, d’adaptabilité, de réversibilité, mais également d’indétermination et d’obsolescence. Le domaine d’études « Héritages, Théories et Création » (HTC) est pensé comme un laboratoire d’étude et de prospective du projet architectural et urbain dans son dialogue avec les héritages théoriques et matériels, leurs potentiels et opérativité pour le projet.
Les architectes doivent développer une culture et une compétence professionnelle et scientifique afin de répondre à ces enjeux et être ainsi en capacité de décrire, comprendre, d’interpréter et de composer. Ce postulat suppose une capacité à identifier les valeurs et les potentiels de l’existant, à déterminer ce qui relève du patrimoine, une compétence dans l’emploi et le développement d’outils et de méthodologies de recherche et d’investigation propres à la discipline architecturale parmi lesquels les outils numériques, en particulier pour le relevé et la restitution, tout en continuant de bénéficier des apports des autres disciplines. L’histoire est ainsi pensée comme matière à projet. Les recherches développées s’intéressent aux héritages théoriques et bâtis, ainsi qu’aux théories et pratiques d’intervention sur l’existant considérées sans exclusive de typologies, d’échelle, de programme ou de période historique. Cependant, le domaine d’étude porte une attention particulière à la conception et au réemploi des espaces sacrés en intégrant la chaire « solutions architecturales pour la conception et le réemploi des espaces sacrés » (SACRES) comme composante.

Les membres de l’équipe dispensent un enseignement de séminaire à l’ENSAPLV dans le cycle master. Ce séminaire d’initiation à la recherche, intitulé Activités et Instrumentation de la Conception, porte sur les problématiques générales de l’équipe du Maacc et se compose de cours et d’exercices de réflexions spécifiques.
Dans la perspective d’obtenir la mention recherche à leur diplôme d’architecte et sous certaines conditions, les étudiants qui le souhaitent peuvent approfondir leur formation à la recherche par le suivi d’un stage au sein de l’équipe de recherche.

